|
|
|
ANGLADE (Joseph).
Les Troubadours de Toulouse.
Toulouse, Privat et P., Didier, 1928, in-12, 210 pp, 10 pl. planches hors texte, figures dans le texte, broché, papier jauni comme toujours, qqs rares marques au stylo en marges, bon état
Ссылка продавца : 30426
|
|
|
FLORI (Jean).
Chevaliers et chevalerie au Moyen Age.
GLM/Hachette, 2000, in-8°, 307 pp, notes, biblio, reliure souple illustrée de l'éditeur, bon état (Coll. La vie quotidienne)
Ссылка продавца : 30484

|
|
|
BARBIER (Pierre).
La France féodale. Tome 1 (seul paru) : Châteaux-forts et églises fortifiées. Introduction à l'étude de l'architecture militaire médiévale en France.
Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1968, gr. in-8°, 508 pp, 159 photos, figures et plans, 2 cartes dépliantes hors texte, broché, bon état
Ссылка продавца : 31383
|
|
|
AUBERT (Marcel), Marcel POBÉ et Joseph GANTNER.
L'Art monumental roman en France.
Editions Braun et Cie, 1964, gr. in-4°, 84 pp, 84 pages de texte suivies de 271 photos de Jean Roubier hors texte reproduites en héliogravure, reliure toile écrue décorée de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état
Ссылка продавца : 31738

|
|
|
AUTRAND (Françoise).
Charles V.
Fayard/GLM, 2000, fort in-8°, 909 pp, 8 pl. d'illustrations hors texte, 7 cartes, 12 tableaux généalogiques, biblio, index, reliure souple illustrée de l'éditeur lég. abîmée, bon état
Ссылка продавца : 32034

|
|
|
BALARD (Michel), Jean-Philippe GENET, Michel ROUCHE.
Des Barbares à la Renaissance.
Hachette, 1973, gr. in-8°, 280 pp, 42 cartes sur 24 pl. hors texte in fine, index, broché, bon état
Ссылка продавца : 32149
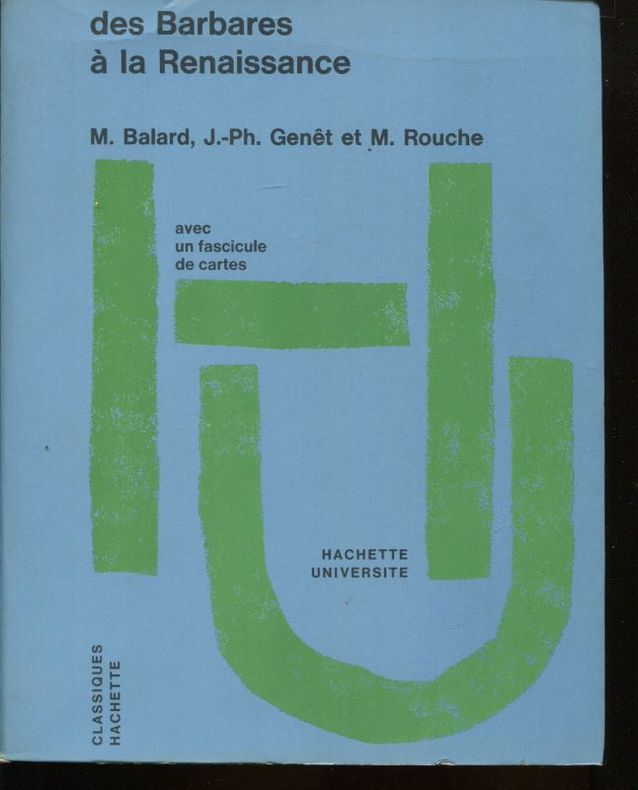
|
|
|
[Collectif] – Société des historiens médiévistes.
L'Histoire médiévale en France. Bilan et perspectives. Préface de Georges Duby. Textes réunis par Michel Balard.
Seuil, 1991, fort in-8°, 567 pp, index, reliiure pleine toile rouge éditeur, jaquette illustrée, gardes piquées, bon état (Coll. l'Univers historique)
Ссылка продавца : 32159

|
|
|
BALARD (Michel)(textes réunis par).
Bibliographie de l'histoire médiévale en France (1965-1990).
Publications de la Sorbonne, 1992, gr. in-8°, ii-486 pp, index, broché, couv. illustrée, bon état
Ссылка продавца : 32160
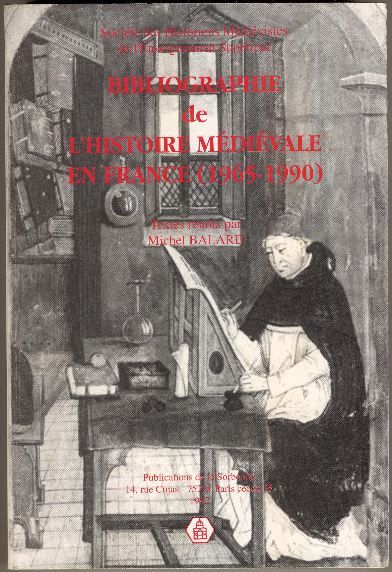
|
|
|
BABELON (Ernest) (publié par).
Les Derniers Carolingiens, d'après Richer et d'autres sources originales.
P., Librairie de la Société bibliographique, 1878, in-12, xi-388 pp, texte traduit et établi par Ernest Babelon, un frontispice, reliure demi-chagrin noir, dos à nerfs soulignés à froid, titres et fleurons dorés (rel. de l'époque), bon état
Ссылка продавца : 32321
|
|
|
BAILLY (Auguste).
Byzance.
Fayard, 1941, in-12, 442 pp, reliure demi-chagrin vert bouteille, dos à 5 nerfs, titres et fleurons dorés, tranches mouchetées, bon état
Ссылка продавца : 32584
|
|
|
BARBE (Dominique).
Irène de Byzance. La femme empereur.
Perrin, 1990, gr. in-8°, 398 pp, 5 cartes, 6 tableaux généalogiques, liste des Empereurs byzantins, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Ссылка продавца : 32820
|
|
|
BONNOT (Isabelle)(dir.).
Marseille et ses Rois de Naples. La diagonale angevine, 1265-1382.
Marseille, Archives minicipales et Aix-en-Provence, Edisud, 1988, in-4°, 181 pp, nombreuses illustrations en noir et en couleurs, chronologie, généalogie, broché, bon état
Ссылка продавца : 33883
|
|
|
BENNASSAR (Bartolomé)(dir.).
Histoire des Espagnols. 1 : VIe-XVIIe siècle.
Armand Colin, 1985, pt in-4°, 560 pp, 32 pl. d'illustrations en couleurs hors texte, nombreuses illustrations en noir dans le texte, cartes, biblio, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état
Ссылка продавца : 34443

|
|
|
BILLARD (Colonel A.).
Jehanne d'Arc et ses juges.
Picard, 1933, pt in-8°, 413 pp, préface de Louis Bertrand, 20 gravures et plans dans le texte et à pleine page, 13 planches et une carte dépliante hors texte, index, reliure pleine toile verte de l'éditeur, qqs très rares soulignures au crayon rouge, bon état
Ссылка продавца : 35295
|
|
|
BLASSELLE (Bruno).
Chemins de rencontre : l'Europe avant la lettre.
Editions Hervas, 1992, in-4°, 180 pp, préface d'Emmanuel Le Roy Ladurie, nombreuses illustrations, la plupart en couleurs, biblio, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, bon état
Ссылка продавца : 36152
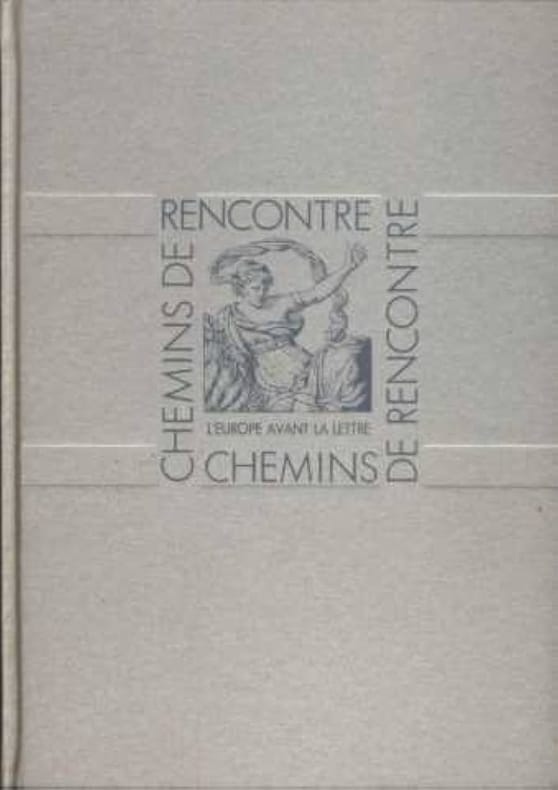
|
|
|
BOGLIONI (Pierre)(dir.).
La Culture populaire au Moyen Age. Etudes présentées au Quatrième colloque de l'Institut d'études médiévales de l'Université de Montréal, 2-3 avril 1977.
Montréal, L'Aurore, 1979, in-8°, 264 pp, 69 gravures, notes, broché, couv. illustrée, bon état
Ссылка продавца : 36175
|
|
|
BOINET (Amédée).
Les Richesses d'art de la ville de Paris. Les Edifices religieux : Moyen Age - Renaissance.
P., Librairie Renouard, H. Laurens, 1910, pt in-4°, vi-210 pp, 64 pl. de gravures hors texte, chronologie des églises de Paris, biblio, index, reliure pleine toile grise illustrée en noir et rouge de l'éditeur, pt accroc sans gravité à un mors, bon état (Coll. Richesses d'art de la Ville de Paris)
Ссылка продавца : 36247
|
|
|
FUSTEL de COULANGES (Numa Denis).
Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France. Les Origines du système féodal : le Bénéfice et le Patronat pendant l'époque mérovingienne.
Hachette, s.d. (1926), in-8°, xv-432 pp, ouvrage revu et complété sur le manuscrit et d'après les notes de l'auteur par Camille Jullian, reliure demi-chagrin noir, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés (rel. de l'époque), bel exemplaire
Ссылка продавца : 36394
|
|
|
BOUDET (Jean-Patrice), Sylvain GOUGUENHEIM, Catherine VINCENT.
L'Europe occidentale chrétienne au XIIIe siècle. Etudes et documents commentés.
SEDES, 1995, in-12, 318 pp, cartes et figures, broché, bon état (Coll. Regards sur l'histoire)
Ссылка продавца : 36517

|
|
|
BORDONOVE (Georges).
Philippe Auguste, le conquérant.
Pygmalion, 1983, gr. in-8°, 317 pp, 8 pl. de gravures hors texte, un plan, notices biographiques, biblio, reliure simili-cuir bleu de l'éditeur, demi-jaquette illustrée, rhodoïd, bon état (Les Rois qui ont fait la France : Les Capétiens, 1). Edition originale reliée et numérotée, tirée à part
Ссылка продавца : 36619
|
|
|
BORDONOVE (Georges).
La Tragédie cathare.
Pygmalion, 1991, gr. in-8°, 459 pp, notices biographiques, biblio, broché, couv. illustrée, bon état
Ссылка продавца : 36625
|
|
|
BON (Antoine).
Byzance.
Nagel, 1972, gr. in-8°, 215 pp, 141 illustrations hors texte dont 90 en couleurs, 2 cartes sur les gardes, biblio, index, reliure éditeur, jaquette illustrée, bon état (Coll. Archaeologia Mundi)
Ссылка продавца : 36680
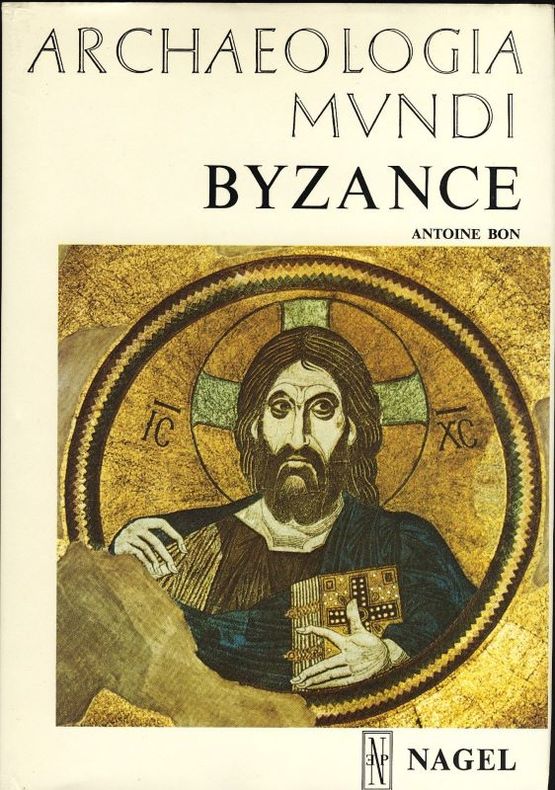
|
|
|
BOUCHON (Geneviève).
Vasco de Gama.
Fayard, 1997, in-8°, 409 pp, 12 pl. de gravures en couleurs hors texte, 8 cartes, chronologie, biblio, glossaire, index, reliure souple illustrée de l'éditeur, bon état
Ссылка продавца : 37149

|
|
|
BOSSUAT (André).
Le Bailliage royal de Montferrand (1425-1556).
PUF, 1957, gr. in-8°, 205 pp, 8 pl. d'illustrations hors texte, sources et biblio, index, broché, couv. lég. salie, non coupé, bon état (Saffroy II, 17284)
Ссылка продавца : 37211

|
|
|
BOUTARIC (Edgard).
La France sous Philippe le Bel. Etude sur les institutions politiques et administratives du Moyen Age.
Plon, 1861, in-8°, viii-468 pp, reliure pleine percaline sable, dos lisse avec pièce de titre basane havane, fleuron à froid, date et double filet doré en queue (rel. de l'époque), bon état
Ссылка продавца : 37352
|
|
|
BRÉHIER (Louis).
Le Monde byzantin. II. Les institutions de l'empire byzantin.
Albin Michel, 1949, in-8°, xviii-631 pp, index, broché, bon état (Coll. L'Evolution de l'Humanité)
Ссылка продавца : 38120
|
|
|
BOUTRUCHE (Robert).
Seigneurie et féodalité. 1. Le premier âge des liens d'homme à homme.
Aubier, 1968, pt in-8°, 478 pp, 2e édition, revue et augmentée, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Historique)
Ссылка продавца : 38147
|
|
|
BOUTIÉ (Louis).
Paris au temps de saint Louis, d'après les documents contemporains et les travaux les plus récents.
Perrin, 1911, in-8°, v-408 pp, 8 gravures hors texte, reliure demi-basane verte, dos à 4 nerfs soulignés à froid, titres et fleurons dorés (rel. de l'époque), dos uniformément passé, bon état
Ссылка продавца : 38243
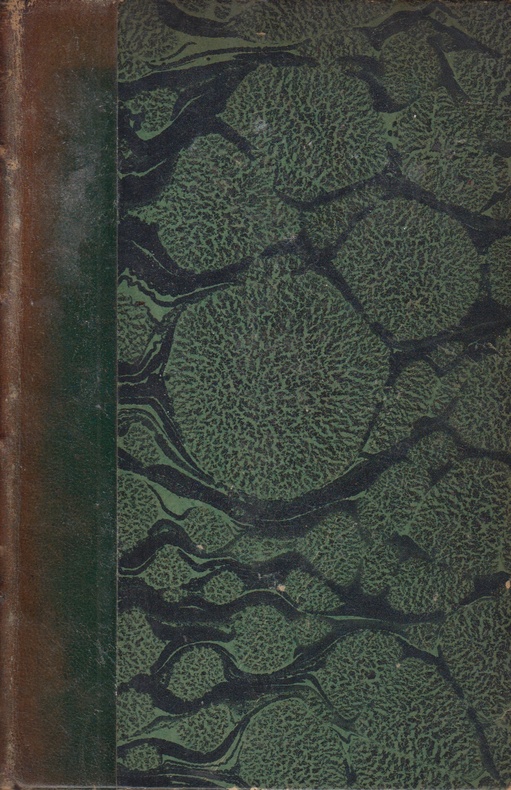
|
|
|
Collectif – Cahiers de Fanjeaux. 2.
Vaudois languedociens et Pauvres catholiques.
Toulouse, Privat, 1967, gr. in-12, 307 pp, 2 cartes (dont une dépliante), 7 planches hors texte, biblio, index, broché, couv. à rabats, bon état (Cahiers de Fanjeaux, 2)
Ссылка продавца : 40019
|
|
|
Collectif – Cahiers de Fanjeaux. 31.
Livres et bibliothèques (XIIIe-XVe siècle).
Toulouse, Privat, 1996, gr. in-12, 565 pp, 43 planches hors texte (dont 4 en couleurs), index, broché, jaquette illustrée, bon état (Cahiers de Fanjeaux. 31)
Ссылка продавца : 40067
|
|
|
BRIDGEFORD (Andrew).
1066. The Hidden History of the Bayeux Tapestry.
London, Fourth Estate, 2004, gr. in-8°, xiv-354 pp, une carte, 4 tableaux généalogiques, notes, biblio, index, reliure percale éditeur, jaquette illustrée, bon état. Texte en anglais
Ссылка продавца : 40865

|
|
|
BOISSONNADE (Prosper).
Du nouveau sur la Chanson de Roland. La genèse historique, le cadre géographique, le milieu, les personnages, la date et l'auteur du poème.
P., Honoré Champion, 1923, gr. in-8°, vi-520 pp, biblio, broché, bon état
Ссылка продавца : 41578

|
|
|
GELLRICH (Jesse M.).
Idea of the Book in the Middle Ages. Language theory, mythology, and fiction.
Cornell University Press, 1986, in-8°, 292 pp, 9 illustrations à pleine page, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état. Texte en anglais
Ссылка продавца : 41861
|
|
|
CHAMPDOR (Albert).
Tamerlan.
Payot, 1957, in-8°, 246 pp, 7 cartes (4 sur double page), biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Bibliothèque Historique)
Ссылка продавца : 42400

|
|
|
CHAMPDOR (Albert).
Tamerlan.
Payot, 1942, in-8°, 246 pp, 7 cartes (4 sur double page), biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Bibliothèque Historique)
Ссылка продавца : 42403
|
|
|
CHEVALIER (Bernard).
L'Occident de 1280 à 1492.
Armand Colin, 1969, gr. in-8°, 256 pp, 16 cartes, 17 tableaux généalogiques, biblio, cart. éditeur, bon état (Coll. U, série Histoire médiévale, dirigée par Georges Duby)
Ссылка продавца : 42801
|
|
|
CHEVALIER (Bernard).
Tours, ville royale (1356-1520). Origine et développement d'une capitale à la fin du Moyen Age. (Thèse).
P. et Louvain, Nauwelaerts, 1975, gr. in-8°, 634 pp, 13 cartes et plans hors texte dont un grand plan dépliant de Tours au début du XVe siècle, généalogies, biblio, index, broché, bon état
Ссылка продавца : 42840

|
|
|
CLOULAS (Ivan).
Laurent le Magnifique.
Fayard, 1987, in-8°, 421 pp, 16 pl. de gravures hors texte, généalogie, sources et biblio, index, reliure souple illustrée de l'éditeur, bon état
Ссылка продавца : 43125

|
|
|
CLOT (André).
L'Egypte des mamelouks. L'empire des esclaves, 1250-1517.
Perrin, 1996, in-8°, 354 pp, une carte, annexes, glossaire, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Ссылка продавца : 43178
|
|
|
GERBIER (Mlle A.).
Marie de Bourgogne.
Tours, Alfred Mame et fils, 1865 in-8°, (4)-235 pp, 3e édition, une gravure en frontispice, cart. toile violine, dos lisse avec titre et ornements dorés, encadrements à froid sur les plats, fer doré au 1er plat, tranches dorées (rel. de l'époque), bon état
Ссылка продавца : 43766
|
|
|
COMMYNES (Philippe de).
Mémoires. Edités par Joseph Calmette avec la collaboration du chanoine G. Durville. Tome I : 1464-1474.
Les Belles Lettres, 1964, in-8°, xxxvi-257 pp, broché, qqs annotations stylo, état correct
Ссылка продавца : 43807

|
|
|
CROUZET-PAVAN (Elisabeth).
Venise triomphante. Les horizons d'un mythe.
Albin Michel, 1999, in-8°, 428 pp, 8 cartes, notes, glossaire, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état
Ссылка продавца : 44165
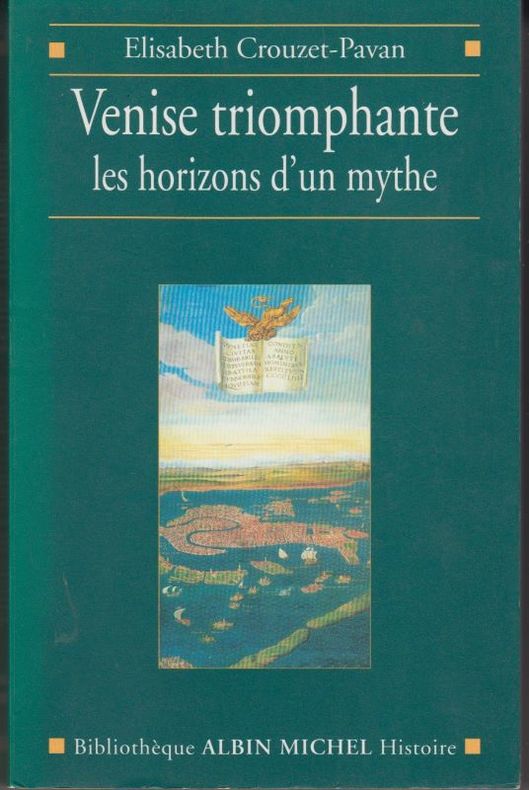
|
|
|
COHEN (Gustave).
Le Théâtre en France au Moyen Age.
PUF, 1948, in-8°, 158 pp, 8 pl. de gravures hors texte, biblio, broché, état correct. Le théâtre religieux. - Le théâtre profane.
Ссылка продавца : 44433
|
|
|
COHEN (Gustave).
Recueil de farces françaises inédites du XVe siècle. Publiées pour la première fois avec une introduction, des notes, des indices et un glossaire.
Genève, Slatkine Reprints, 1974, in-8°, xxxii-459 pp, introduction, notes, glossaire des mots rares ou difficiles, 4 index, reliure simili-cuir bordeaux de l'éditeur, bon état. (Réimpression de l'édition de Cambridge, 1949)
Ссылка продавца : 44451
|
|
|
CHATELAIN (André).
Evolution des châteaux forts dans la France au Moyen Age.
Strasbourg, Publitotal, 1988, in-4°, 319 pp, texte sur deux colonnes, 338 plans, figures et photographies dans le texte, quelques-unes en couleurs à pleine page, biblio, index, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, jaquette illustrée, très bon état
Ссылка продавца : 44960
|
|
|
DAILLIEZ (Laurent).
Les Templiers et les règles de l'ordre du Temple.
Belfond, 1972, in-8° carré, 267 pp, texte sur 2 colonnes, chronologie, 17 pl. de gravures et photos, reliure simili-cuir noir avec titres dorés de l'éditeur, bon état (Coll. Sciences secrètes)
Ссылка продавца : 45468

|
|
|
CURVEILLER (Stéphane).
Dunkerque, ville et port de Flandre à la fin du Moyen Age, à travers les comptes de baillage de 1358 à 1407. (Thèse).
Presses Universitaires de Lille, 1989, gr. in-8°, 374 pp, préface de Gérard Sivéry, 3 pl. en couleurs hors texte, 8 cartes et plans, 32 illustrations dans le texte, un tableau généalogique, sources, index, glossaire, broché, couv. illustrée à rabats, bon état
Ссылка продавца : 45471
|
|
|
DEANESLY (M.).
Histoire de l'Europe du Haut Moyen-Age (476 à 911).
Payot, 1958, fort in-8°, 755 pp, traduit de l'anglais, préface de Robert Fawtier, 5 cartes, index, broché, bon état (Coll. Bibliothèque historique)
Ссылка продавца : 45805
|
|
|
DAWSON (Christopher).
Le Moyen Age et les origines de l'Europe, des Invasions à l'an 1000.
Arthaud, 1960, in-8°, 335 pp, préface de Jacques Le Goff, 73 illustrations reproduites en héliogravure sur 52 pl. hors texte, cartes, index, biblio, reliure pleine toile écrue décorée de l'éditeur, rhodoïd, bon état
Ссылка продавца : 45964
|
|
|
DAYOT (Armand).
Le Moyen Age. La Gaule romaine - Les Invasions - La France féodale - La Royauté.
P., Ernest Flammarion, s.d. (v. 1905), in-4° à l'italienne, 236 pp, 1161 illustrations, reliure demi-chagrin carmin à coins éditeur, dos à 5 faux nerfs et fleurons dorés, décor doré sur le 1er plat, filets dorés sur les plats, tête dorée (rel. de l'époque), coins émoussés, bon état. Précieuse et très importante documentation iconographique sur le sujet.
Ссылка продавца : 45996
|
|
|